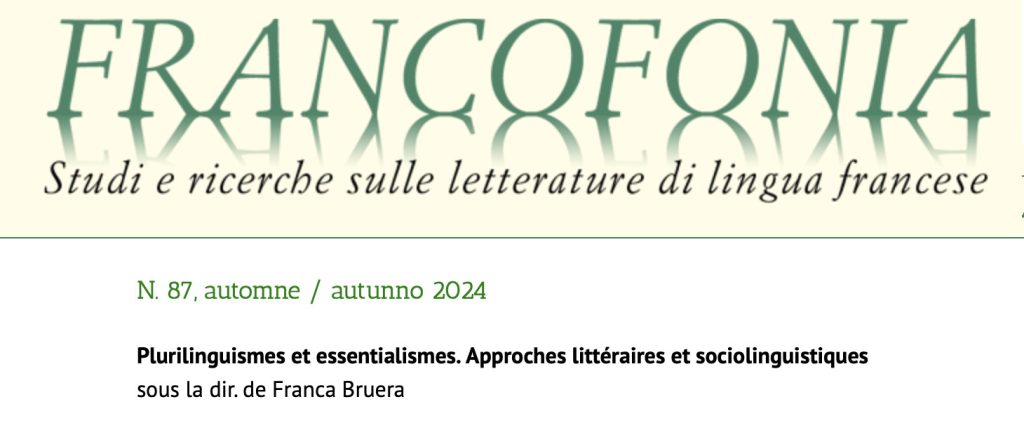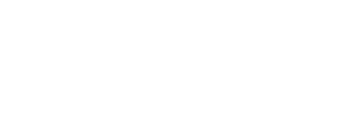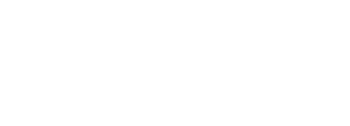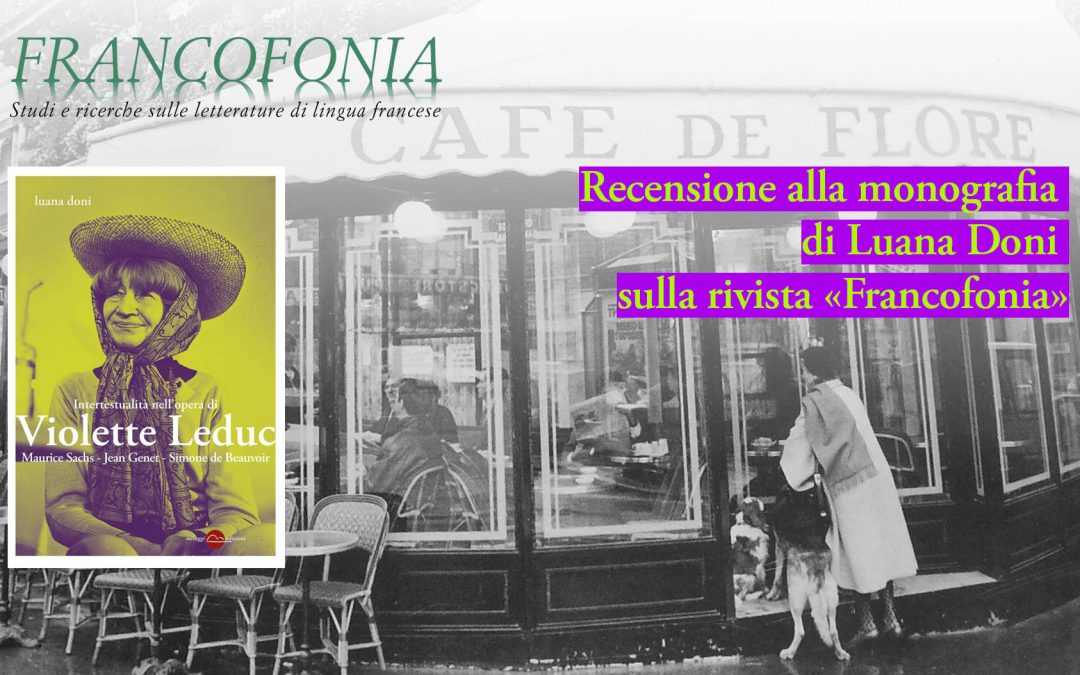di DINA CATENARO CATENARO
Le texte Intertestualitànell’ope- radiVioletteLeduc,MauriceSachs –JeanGenet–SimonedeBeauvoir de Luana Doni donne une nouvelle clé de lecture de l’œuvre de l’écri- vaine française Violette Leduc dont les études ont été plutôt fructueuses au cours des dernières années.
À travers le prisme de l’intertex- tualité, qui renvoie au lecteur les re- flets des relations complexes et sou- vent subtiles entre différents textes littéraires, Doni analyse de manière captivante les stratégies utilisées par Leduc pour dialoguer avec cer- taines œuvres de ses mentor : celles de Maurice Sachs (en particulier Le Sabbat), de Jean Genet (Le Miracle de la Rose, Notre-Dame-des-Fleurs) et de Simone de Beauvoir (L’Invi- tée, La Femme rompue et Les In- séparables), écrivains phares pour son écriture. Une écriture qui naît, comme Luana Doni le souligne, de la rencontre avec les autres.
Une autre particularité de cet es- sai souligne son caractère inédit : la volonté de montrer l’originalité de l’écriture leducienne en la privant des préjugés qui ont parfois accom- pagné l’analyse de son œuvre, sou- vent liée au personnage Leduc.
Le premier chapitre s’ouvre sur une présentation de l’écrivaine, de la genèse de son écriture ainsi que des principales études critiques qui lui ont été consacrées. Doni y ex- pose ensuite la démarche métho- dologique qu’elle adopte : à une analyse intertextuelle synchronique –mettant en relation l’œuvre de Le- duc avec les grandes figures de la littérature française, de Verlaine et Rimbaud à Colette, Proust ou en- core Gide – s’ajoute un ensemble de références à la littérature contempo- raine, notamment Jouhandeau, Leh- mann et, de manière plus marquée, Cocteau. L’autrice mobilise par ail- leurs les cadres théoriques de l’in- tertextualité proposés par Mikhaïl Bakhtine, dans sa conception poly- phonique, ainsi que les typologies de Gérard Genette. Chez Violette Leduc, l’intertextualité interne se manifeste avec une particulière in- tensité dans la trilogie autobiogra- phique, où l’écrivaine réintègre des éléments de ses textes antérieurs afin de consolider la structure en chaîne de l’ensemble. Selon Doni, LaBâ- tarderévèle de manière exemplaire cette organisation réticulaire, tout en offrant au lecteur une perception claire du projet littéraire de Leduc. Le deuxième chapitre se concentre sur les rapports qui s’entrelacent entre l’écriture de Leduc et celle de Maurice Sachs, l’auteur qui lui a ou- vert les portes de la littérature. La présence de Sachs, son grand inter- locuteur littéraire, devient pour Le- duc l’occasion pour interpeller Gide, Cocteau, Jacob. Doni souligne à plu- sieurs reprises le rôle fondamental joué par cette figure singulière dans la vie et dans l’œuvre de l’écrivaine : une présence qui hantera comme un fantôme toute son écriture à partir de son premier roman, L’Asphyxie. Dans cette section, Doni met en comparaison les passages de cer- taines pages des romans de Leduc avec ceux de Maurice Sachs, en mon- trant comment les trois composantes essentielles du style Leduc (amour, mystique et mort) ont été influencés par l’écriture de Sachs. Le chapitre est particulièrement intéressant car le dialogue entre les textes de Sachs et ceux de Leduc devient aussi l’occa- sion pour découvrir l’influence exer- cée sur les écrivains par les maîtres de leur formation littéraire, des symbo- listes Verlaine et Rimbaud aux plus contemporains Proust, Gide et Coc- teau.
Vient ensuite le chapitre 3 – Jean– consacré à l’auteur qui a proba- blement le plus influencé sa produc- tion littéraire, Jean Genet. L’écrivain subversif par excellence devient très tôt son frère littéraire, au sein d’un rapport caractérisé par une estime littèraire réciproque. Genet, avec le- quel l’écrivaine partage la connais- sance de Sartre (qui protège jalou- sement) et Simone de Beauvoir, exprime toute son admiration pour L’Affamée.
Les deux écrivains entretiennent une relation d’amitié particuliè- rement intense, marquée par une forte complicité, qui connaîtra tou- tefois une rupture brutale à l’occa- sion d’une répétition générale de la pièce Les Bonnes de Genet — ini- tialement dédiée à Leduc. Cet épi- sode conflictuel ne met cependant pas un terme à leur dialogue artis- tique, chacun demeurant, malgré les tensions, une source d’inspiration créative pour l’autre.
L’analyse proposée par Doni s’at- tarde plus spécifiquement sur les ré- sonances du Miracledelarosede Jean Genet, dont l’influence se mani- feste à plusieurs reprises dans L’Af- famée, LaFolieentêteet LaChasseà l’Amour de Leduc, tout en exerçant également une empreinte notable sur ThérèseetIsabelle. En parallèle, Ravageset Trésorsàprendreentre- tiennent des affinités intertextuelles plus explicites avec un autre roman de Genet, Notre-Dame-des-Fleurs. Doni met notamment en évidence la genèse intertextuelle complexe de l’ensemble Thérèse et Isabelle – Ravages, dont le processus d’écri- ture demeure fragmentaire et par- tiellement obscur.
Elle souligne que le langage éro- tique/amoureux utilisé par Leduc prend forme grâce aussi à la lecture de Genet : la rose évoquée dans les œuvres de l’écrivain est omnipré- sente dans celles de Leduc, mais c’est surtout l’aspect de la littéra- ture bâtarde, au-delà des catégori- sations de genre, qui rapproche les écritures des deux écrivains.
Le dernier chapitre, dans le- quel Doni explore les liens entre Simone de Beauvoir et Violette Leduc, aborde un terrain déjà lar- gement étudié, ce qui l’inscrit dans une continuité critique bien établie. On revient sur l’événement, la ren- contre entre les deux écrivaines en février 1945 au Café de Flore, sur la fascination exercée par Beauvoir sur Leduc, sur l’ambiguïté de l’at- titude de Simone de Beauvoir par rapport à cette écrivaine émergente et sur la révision puis la censure de certains passages de l’œuvre de Le- duc par Beauvoir.
Certainement, les pages concer- nant le travail de censure sur Ra- vageset ThérèseetIsabelle, selon les études de Catherine Viollet, le cas du récit Le Taxi et, surtout, la publication posthume par Simone de Beauvoir du dernier roman de la trilogie autobiographique, La Chasse à l’amour, s’avèrent plus riches d’un point de vue analytique. En reve- nant sur une étude effectuée par Mireille Brioude, « Une simple er- reur de date ? Les révélations des derniers feuillets de La Chasse à l’amour» (2019), Doni met en lu- mière la singularité du dernier pa- ragraphe du roman qui se conclut précipitamment et avec un style qui diffère beaucoup de celui de Vio- lette Leduc, riche en métaphores et en suggestions. Les études sur la partie conclusive de LaChasseà l’amour sont encore en cours et c’est sur cette voie encore à parcourir que Doni achève son essai.
En explorant les références in-tertextuelles dans l’œuvre de Le- duc, Doni offre une analyse appro- fondie de la manière dont l’écrivaine tisse un réseau complexe de signi- fications et de résonances à travers ses textes. Cette approche permet de mieux comprendre la profondeur et la richesse de l’œuvre de Violette Le- duc et son importance dans le pay- sage littéraire français, mettant en lumière sa puissance créatrice et les enjeux d’une écriture aux multiples facettes.